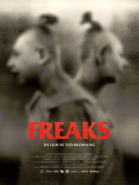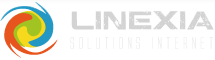Actualités :
23.01.25
Info parution : "De Palma, Mana, Cinéma. L'Impasse (Carlito's Way, 1993), par Jean-François BUIRÉ
Notre ami et collaborateur occasionnel Jean-François BUIRÉ signe un livre percutant, intégralement consacré à Carlito's Way (L'Impasse), l'un des meilleurs films de Brian DE PALMA. Nous conseillons donc vivement la lecture de cette analyse...
Lire la suite30.12.24
ÉCLIPSES N°75 : Jean-Luc GODARD, que peut le cinéma ?
ÉCLIPSES N°75 : Jean-Luc GODARD, que peut le cinéma ? Sous la direction de Alexia ROUX et Saad CHAKALI À 20 ans, ce fils bien né (son père est médecin, sa mère issue d’une grande lignée suisse protestante enrichie dans la banque) rompt...
Lire la suite20.12.24
Info Parution : "CINÉCASABLANCA, la Ville Blanche en 100 films", par Roland CARRÉE et Rabéa RIDAOUI
Notre collaborateur et coordinateur Roland CARRÉE publie un livre consacré aux films tournés à Casablanca, co-écrit avec Rabéa RIDAOUI, également collaboratrice à la revue ÉCLIPSES. Dès les premiers films de l’époque coloniale,...
Lire la suiteLes derniers articles
publiés sur le site
09.12.24
Revoir
Film : Freaks
On ne naît pas monstre, on le devient
Réalisateur : Tod Browning
Auteur : Paul Montarnal
Lire l'article19.04.12
Revoir
Film : Le Locataire
Elle et l’huis clos (3/3)
Réalisateur : Roman Polanski
Auteur : Youri Deschamps
Lire l'article17.04.12
Revoir
Film : Rosemary's Baby
Elle et l’huis clos (2/3)
Réalisateur : Roman Polanski
Auteur : Youri Deschamps
Lire l'articleRevoir : L'Amour existe
L'Amour existe
(Maurice Pialat, 1960)
Quiconque a déjà vu ne serait-ce qu’un seul film de Pialat ne manquera pas de s’étonner de l’affirmation contenue dans ce titre. L’amour, c’est bien le point de fuite de tout le cinéma de l’auteur de Van Gogh (1991), l’horizon qui fait tenir ensemble la totalité de sa filmographie. Mais de L’Enfance nue (1969) au Garçu (1995), l’amour et la vie ne vieillissent pas ensemble. Toujours, le chemin qui mène à l’Autre est abrupt, coupant, brutal et sans pitié. Au seuil de l’œuvre, L’Amour existe, donc, mais le bonheur n’est pas gai et laisse sourdre une révolte lucide, passionnée et difficile à contenir.
Cinéaste de la marge n’ayant jamais fait école, on ne s’étonnera guère, en revanche, que Pialat entre en cinéma par la zone franche. Car, en effet, qu’est-ce que la banlieue si ce n’est la mise au ban du lieu ? Qu’est-ce que vivre en banlieue si ce n’est être banni du lieu qui compte, c’est-à-dire le centre ville, le site historique, là où se dépose « la mémoire officielle et où se localise le passé certifié » ? Les banlieusards, nous montre Pialat, ce sont des gens que l’on enferme à l’extérieur de la ville. Brûlot poétique, L’Amour existe est aussi un grand film politique, un véritable précis de géographie sociale, un traité d’urbanisme critique et vibrant, en avance de trente ans si l’on se repère à la pauvre boussole des médias contemporains.
Dès le prologue, la caméra de Pialat s’attache à la description nue des transports inhumains subis par les voyageurs du commun, grappes solitaires et muettes absorbées et recrachées par la bouche d’ombre du métro. Sitôt que l’on passe le pont, ce sont bien des fantômes qui viennent à notre rencontre, ceux des temps passés. Un train file au loin, mais la rumeur des locomotives s’est tue, et depuis l’intérieur d’un appartement figé dans le silence, la caméra s’avance lentement vers la fenêtre. La voix du commentaire, d’une rare qualité littéraire, écrit par Pialat lui-même et dit à la première personne, convoque le souvenir : « Longtemps, j’ai habité la banlieue […] La mémoire et les films se remplissent d’objets qu’on ne pourra jamais plus appréhender ». C’est vers ces lieux de mémoire, « châteaux de l’enfance qui s’éloignent », que le film retourne d’abord : une église épargnée par les bombes, une salle de classe déserte, un cinéma vide. La succession de travellings patients évoque une progression personnelle, comme un promeneur invisible arpentant des territoires fantomatiques et dépeuplés. La note, d’emblée, est donnée, et tout le film s’y accroche en variations et déclinaisons : c’est l’absence et le gel, le figement forcé du temps dans l’itération définitive qui caractérisent la vie en banlieue. La récurrence de tous ces trains qui vont et reviennent de part et d’autre de l’image, à plusieurs endroits du film, prépare la comparaison et précise le discours : charrettes fantômes menées par le cocher de la mort au travail, les trains de banlieue ordonnent la déportation au quotidien de toutes ces vies « dont le futur a déjà un passé, et le présent un éternel goût d’attente ».
Plus tard, quand vient le temps des « casernes civiles » et des meurtrières en guise de fenêtres, l’innommable est prononcé ; le constat frappe, terrible : « univers concentrationnaire payable à tempérament, urbanisme pensé en termes de voirie […] les entrepreneurs entretiennent la nostalgie des travaux effectués pour le compte de l’Oganisation Todt ». Rappelons que l’Organisation Todt (du nom de son premier chef, Fritz Todt) fut une structure de l’Allemagne nazie, notamment chargée de la construction de la ligne Siegfried et du mur de l’Atlantique, pour lesquels elle reçut l’appoint du travail forcé. Cette « nostalgie » attribuée aux modernes bâtisseurs de bunkers à loyer modéré, précise bien l’ampleur de la révolte dont le film témoigne admirablement.
Le dernier segment retrouve le train qui convoie la litanie des heures grises et l’écume des jours : « Départ à la nuit noire. Course jusqu’à la station. Trajet aveugle et chaotique au sein d’une foule serrée et moite. Plongée dans le métro tiède. Interminable couloirs de correspondance. Portillons automatiques. Entassement dans des wagons surchargés. Second trajet en autobus. Le travail est une délivrance. Le soir, on remet ça ». Là, le commentaire s’accélère, redouble la mécanique inexorable, et le montage démonte la machine à broyer les âmes, celle qui oeuvre à l’indistinction des corps, à l’extinction de la personne. Toujours sur la même ligne de force, vers la fin du film, après un passage sans appel par les bidonvilles de Nanterre assaillis par les flammes d’un incendie que l’on n’oserait qualifier de « domestique » (« ils existent, à trois kilomètres des Champs-Élysées »), un mouvement de caméra va chercher dans les décombres une plaque indiquant la rue « d’Oradour-sur-Glane », du nom de ce village de Haute-Vienne tristement entré dans l’histoire des atrocités nazies (le 10 juin 1944 a vu 642 victimes, dont plus de 450 femmes et enfants brûlés vifs dans l’église). La position de Pialat est on ne peut plus claire. L’abject du moment est condensé en une phrase : « de plus en plus, la publicité prévaut contre la réalité » ; un paravent que lève l’alternance de deux séquences qui font se côtoyer les sirènes criardes des promoteurs et le silence blanc de la détresse et du dénuement. Un film comme un cri de poésie et de révolte, pour instruire la leçon des ténèbres, celle « qui n’est jamais inscrite au flanc des monuments ».