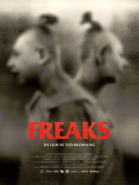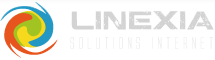Actualités :
23.01.25
Info parution : "De Palma, Mana, Cinéma. L'Impasse (Carlito's Way, 1993), par Jean-François BUIRÉ
Notre ami et collaborateur occasionnel Jean-François BUIRÉ signe un livre percutant, intégralement consacré à Carlito's Way (L'Impasse), l'un des meilleurs films de Brian DE PALMA. Nous conseillons donc vivement la lecture de cette analyse...
Lire la suite30.12.24
ÉCLIPSES N°75 : Jean-Luc GODARD, que peut le cinéma ?
ÉCLIPSES N°75 : Jean-Luc GODARD, que peut le cinéma ? Sous la direction de Alexia ROUX et Saad CHAKALI À 20 ans, ce fils bien né (son père est médecin, sa mère issue d’une grande lignée suisse protestante enrichie dans la banque) rompt...
Lire la suite20.12.24
Info Parution : "CINÉCASABLANCA, la Ville Blanche en 100 films", par Roland CARRÉE et Rabéa RIDAOUI
Notre collaborateur et coordinateur Roland CARRÉE publie un livre consacré aux films tournés à Casablanca, co-écrit avec Rabéa RIDAOUI, également collaboratrice à la revue ÉCLIPSES. Dès les premiers films de l’époque coloniale,...
Lire la suiteLes derniers articles
publiés sur le site
09.12.24
Revoir
Film : Freaks
On ne naît pas monstre, on le devient
Réalisateur : Tod Browning
Auteur : Paul Montarnal
Lire l'article19.04.12
Revoir
Film : Le Locataire
Elle et l’huis clos (3/3)
Réalisateur : Roman Polanski
Auteur : Youri Deschamps
Lire l'article17.04.12
Revoir
Film : Rosemary's Baby
Elle et l’huis clos (2/3)
Réalisateur : Roman Polanski
Auteur : Youri Deschamps
Lire l'articleRevoir : Le Criminel
Le Criminel
(Orson Welles, 1946)
Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme,
Ô Beauté ! ton regard, infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l'on peut pour cela te comparer au vin
Charles Baudelaire, Hymne à la beauté.
Se délecter avec ivresse du spectacle du mal, contempler dans un même élan de dégoût et de fascination les gesticulations des créatures maléfiques de la pellicule, voilà une des raisons (parmi au moins mille autres) d'aimer le cinéma.
Orson Welles s'est particulièrement attaché à cette représentation, à la peinture minutieuse d'êtres submergés par la tentation du franchissement d'une frontière morale. Dans le cinéma hollywoodien des années quarante, le mal se conçoit dans une acceptation dialectique chrétienne, un acte conscient contraire aux volontés divines, une privation d'un bien selon Thomas d'Aquin. La limite est clairement délimitée dans un cinéma qui a encore des prétentions didactiques et qui se veut avant tout consensuel et populaire.
L'échec commercial et critique du citoyen Kane comme celui des tribulations de la famille Amberson force Welles à accepter de réaliser en 1946 Le Criminel (The Stranger), et de prouver aux producteurs de la RKO qu'il est capable de réaliser un succès. Comment dès lors le Welles artiste prend-t-il en charge la représentation du mal ? Comment concilie-t-il cahier des charges précis et velléités artistiques ?
Son Franz Kindler, sinistre bourreau nazi caché aux États-Unis, est un démon à la beauté envoûtante, un Belzébuth dont le masque humain craque de toute part ; mais c'est ce portrait a priori manichéen et simpliste qui permet au cinéaste une peinture du mal bien plus complexe et personnelle.
Une simple esquisse...
Franz Kindler, interprété par Welles lui-même, a refait sa vie dans une petite bourgade du Connecticut, Harper. Maintenant Charles Rankin, il est un professeur d'histoire parfaitement intégré à la communauté, et s'apprête à épouser la fille d'un juge siégeant à la Cour Suprême. Cet idéologue du IIIe Reich a, comme il le dit lui-même, la charge des « fils de l'Amérique », il peut à loisir distiller son suc vénéneux et préparer la prochaine guerre. Mal insidieux, mal caché, Kindler est « cette ordure » que l'inspecteur Wilson lancé à sa poursuite dit chercher à détruire.
Ce film est réalisé au moment où les images des camps filmés par George Stevens ou Samuel Fuller ont révélé au monde la réalité des camps de concentration. Le nazi est alors le plus à même de figurer le mal dans l'industrie cinématographique hollywoodienne, un mal démoniaque, vaincu par les troupes du bien américaines. Le réalisateur peint Kindler comme un être totalement possédé, ayant franchi les limites de la folie, pour qui tout exorcisme est impossible. Il ne peut s'empêcher lors d'une discussion de voir dans l'extermination totale d'un peuple un acte politique radical et efficace.
La créature au service du mal élimine de façon définitive celui qui se voulait sa mauvaise conscience, sa part d'humanité. Son ancien complice Meineke, devenu prêcheur, tente de pousser Kindler à un improbable repentir, afin qu'il obtienne un encore plus hypothétique pardon du Créateur. Sans aucun scrupule, Kindler choisit la voie de l'impénitence et, étranglant Meineke, le renvoie hors-cadre vers des profondeurs infernales. « Il livre les méchants au glaive, dit l'éternel » (Jérémie, 25:31). Seul le courroux divin peut l'anéantir, le démon finit transpercé par la statue d'un ange brandissant une épée.
Le regard de Welles sur le mal est-il aussi manichéen qu'il semble l'être ? Film de commande, le cinéaste se plie au scénario de John Huston et esquisse un personnage sans aucune ambiguïté. Mais s'il y a manichéisme des personnages et simplicité - apparente - du propos, le respect strict du cahier des charges laisse à l'artiste le loisir de déployer un autre discours dans la mise en forme de son film.
Aux couleurs vénéneuses
Le coup de pinceau de Welles transparaît dès la séquence d'ouverture. Cadrages appuyés, grands angles, gros plan sur des visages/paysages, mouvements de caméra permanents, la plongée dans le récit est tout de suite intense et marquante. La photo quasi-expressionniste de Russel Metty magnifie cette mise en scène baroque, s'inspirant tant de l'expressionnisme d'un Fritz Lang que de l'esthétique des films noir de la Warner.
Welles ne se réfugie cependant pas dans un formalisme maniéré, qui relèguerait l'horreur nazie à un imaginaire démoniaque. L'inspecteur Wilson tente de convaincre la femme de Kindler de la véritable nature de l'homme qu'elle a épousé en la forçant à regarder ce dont il est responsable, en lui projetant des films des charniers et des chambres à gaz. Premier cinéaste à intégrer dans une fiction les images des camps filmés par les opérateurs de la Specou (Special Coverage Unit, unité spéciale de tournage), l'enfer dont est issu Kindler n'appartient plus au domaine de la croyance religieuse, il est explicitement désigné et tragiquement réel. « Pourquoi dois-je regarder ces atrocités ? » s'interroge la femme de Kindler : il s'agit de retirer les œillères des spectateurs, de ne pas se contenter des représentations rassurantes d'un mal inhumain et fantasmatique, mais de véritablement l'incarner, de proposer une vision insoutenable car malheureusement trop humaine.
Retirer ce qui soumet « la pensée à un servage toujours plus dur » disait Breton dans Le second manifeste du surréalisme, montrer le monde tel qu'il est et ne pas se réfugier derrière des paravents. Le recours au plan-séquence s'inscrit dans une même démarche. La mise à mort par Kindler de Meineke, ancien complice devenu une menace, est filmée en un long plan-séquence de quatre minutes. La promenade dans les sous-bois du criminel avec sa future victime se fait en temps réel, depuis l'accolade lors de leurs retrouvailles jusqu'à l'étranglement final. Cette expérience temporelle nous offre une descente en apnée vers les profondeurs du mal, une plongée où la respiration filmique classique est absente, où l'enchaînement rationnel – divin ? – des plans selon le principe de causalité action/réaction laisse la place à un bloc d'espace-temps régi par le seul bon vouloir de Kindler. Plus de dialectique rassurante et binaire, triomphe d'une réalité tragique propre à la condition humaine, Par-delà le bien et le mal dirait Nietzsche.
Lucifer, plus bel ange du ciel, fut précipité en enfer pour s'être révolté contre Dieu ; Orson Welles paye sa liberté de ton et son talent dans sa mise à l'écart progressive et définitive de l'industrie cinématographique.